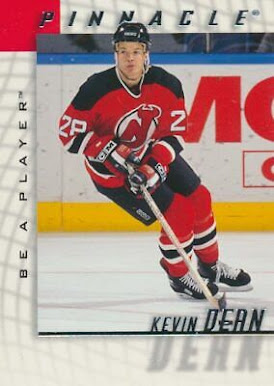Chaque édition de champions qui se retrouve inscrite annuellement sur le trophée comporte son lot d'histoire et de petits détails fascinants. Il y a bien sûr des joueurs vedettes que l'on reconnait inévitablement, mais moi, ce que je préfère, ce sont évidemment les joueurs no-names ou ceux que je ne me souvenais pas qu'ils avaient joué avec l'équipe ou même qu'ils avaient gagné la coupe. Parfois aussi, ce sont les membres du staff qui me fascinent.
Donc, au cours du texte, je porte mon choix sur un ou deux joueurs qui détonnent du lot par leur présence.
Aujourd'hui, après une pause de quelques mois, revoici la suite avec les Devils de 1995.
Chapitres précédents: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Joueurs: Neal Broten, Jim Dowd, Brian Rolston, Bobby Holik, Sergei Brylin, Bob Carpenter, Randy McKay, Mike Peluso, Bill Guerin, John MacLean (A), Tom Chorske, Danton Cole, Claude Lemieux, Valeri Zelepukin, Stéphane Richer, Scott Stevens (C), Ken Daneyko, Tommy Albelin, Chris McAlpine, Bruce Driver (A), Scott Niedermayer, Kevin Dean, Shawn Chambers, Martin Brodeur, Chris Terreri
Staff: John J. McMullen (Owner/Chairman/Governor), Peter McMullen (Vice President), Lou Lamoriello (President/General Manager), Jacques Lemaire (Head Coach), Jacques Caron (Goaltender Coach), Dennis Gendron (Asst. Coach), Larry Robinson (Asst. Coach), Robbie Ftorek (AHL Coach), Alex Abasto (Asst. Equipment Manager), Bob Huddleston (Massage Therapist), Dave Nichols (Equipment Manager), Ted Schuch (Medical Trainer), Mike Vasalani (Strength-Conditioning Coach), David Conte (Director of Scouting), Milt Fisher (Scout), Claude Carrie (Scout), Dan Labraaten (Scout), Marcel Pronovost (Scout)
----------------
D'abord pour les quelques faits divers cocasses et/ou semi-intéressants de cette finale, et bien il s'agissait de la première fois depuis 1980 (New York vs. Philadelphie) que la finale se disputa entièrement dans le même fuseau horaire. Heille on peut pas dire que je ne vous apprends jamais rien...
Il s'agissait également de la première de 9 finales consécutives à ne pas avoir une équipe canadienne dans les finalistes, ce qui demeure le record à ce jour, qui fut toutefois égalé par l'écart entre la présence en finale des Canucks en 2011 et celle du Canadien en 2021. Avant cet écart 1995-2004 (Flames vs. Lightning), le maximum avait été de seulement deux saisons et ce depuis la création du trophée en 1893.
Aussi comme la saison 1994-1995 avait dû être écourtée à seulement 1995 à cause du lock-out, la victoire des Devils fut retardée jusqu'au 24 juin 1995, ce qui était alors la date la plus tardive jamais vue jusque-là. Lors de l'autre finale affectée par un lock-out, celle de 2013, on assista également à une remise le jour de la St-Jean, encore le 24 juin, 2013 cette fois-ci.
Ce record de date fut ensuite anéanti à jamais (on l'espère crissement) lors des séries compliquées covidiennes de 2020 alors qu'on dut attendre jusqu'au 28 SEPTEMBRE! Je sais, ça fait pas si longtemps mais on dirait que j'en reviendrai jamais de ça... Le lendemain, les joueurs commençaient leur entrainement d'été et le surlendemain c'était le camp d'entrainement...
----------------
Mais bon, assez parlé de ces années de marde.
Pour ce qui est des joueurs inscrits sur la coupe de 1995 des Devils, il y a plusieurs noms ici qui nous surprennent par le fait qu'on ignorait ou oubliait que le joueur ait remporté la coupe Stanley ou même qu'il avait joué avec les Devils tout court. Ou encore qu'il était encore avec l'équipe à ce moment. C'est le cas des Jim Dowd, Tom Chorske, Brian Rolston ou encore d'un Chris McAlpine. Un gros WTF d'ailleurs pour ce dernier alors que dans ma tête il avait seulement joué pour les Blues. Mais en fait non, il avait été repêché par New Jersey en 1990 et y a seulement joué durant cette saison écourtée de 1995, pour 24 matchs en saison et aucun en séries... Il se qualifiait toutefois pour être gravé car la limite normale de 41 matchs avait été abaissée.
Il y a aussi ces bons vieux cas de joueurs vétérans qui en méritaient finalement une comme Neal Broten, Bruce Driver, John MacLean, Shawn Chambers et Bob Carpenter. Stéphane Richer en méritait bien une deuxième. Bill Guerin, encore tout jeune, devra ensuite attendre en 2009 avec Pittsburgh pour en remporter une deuxième.
Mais donc qui choisir comme véritable joueur «LVEUP-WTF-quessé qu'il fait là lui»?
Et bien dans ce cas-là, je prends souvent le plus no-name du lot, et ici il s'agit de nul autre que Kevin Dean.
Who the fuck is Kevin Dean?Et bien l'actuel assistant-entraineur des Blackhawks est un cas super intéressant qui me réjouit beaucoup car lorsque je choisis d'écrire comme ici sans retenue avant de checker de quoi je parle avant de choisir d'en parler, et bien parfois j'ai pas grand chose à dire sur le joueur.
Mais ici non. Joueur de défense, Dean avait d'abord été un choix de 5e ronde des Devils en 1987. Il joua ensuite 4 années dans la NCAA avant de débuter son parcours dans les filiales des Devils. Ce n'est que durant cette saison écourtée de 1995 qu'il parvint finalement à jouer dans la LNH avec le grand club, jouant 17 matchs en saison et 3 en séries.
Et comme la saison 1995 avait dû voir sa finale être repoussée jusqu'à la fin juin, il n'en était pas le cas dans les mineures, alors que la finale de la ligue américaine fut remportée le 26 mai 1995. Cette finale mettait aux prises les River Rats d'Albany contre les Canadiens de Fredericton et fut remportée par les River Rats, qui étaient alors le club-école des Devils.
Donc les Devils et leur club-école ont remporté le trophée le championnat de leur ligue respective la même saison, ce qui représentait la troisième fois, et à ce jour la dernière, qu'on assistait à un tel exploit pour une organisation. La première fois avait eu lieu en 1975-76 lorsque les Canadiens remportèrent la coupe Stanley et leur club-école, les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, remportèrent la coupe Calder. L'organisation répéta ensuite l'exploit la saison suivante, soit en 1976-77.
En plus de Kevin Dean, quelques autres joueurs comme Sergei Brylin et Chris MacAlpine avaient aussi joué avec les River Rats et les Devils durant la saison. Mais Dean est le seul du lot à avoir joué des matchs en séries pour Albany. Il avait alors joué 8 des 14 matchs du parcours des River Rats. Il m'est impossible de vérifier s'il a joué durant la finale contre Fredericton mais s'il a été ensuite choisi en renfort par les Devils quelques semaines plus tard, j'ose imaginer que oui.
J'ignore cependant quels sont les critères pour avoir officiellement
fait partie d'une équipe championne de la coupe Calder, mais selon ce
que j'ai pu voir, seulement les joueurs ayant joué en séries semblent
être considérés. Un joueur comme Sergei Brylin avait joué 67 matchs en
saison avec les River Rats mais fut rappelé en fin de saison. Il ne joua
aucun match en séries avec Albany et ne semble pas faire partie de la liste de
l'équipe championne.
Cela ferait donc de Kevin Dean un des seuls joueurs de l'histoire à avoir remporté la coupe Calder et la coupe Stanley la même saison. J'ai vérifié avec les deux éditions de Montréal/Nouvelle-Écosse de 76 et 77 et les seuls autres joueurs à avoir gagné les deux coupes comme Dean sont Pierre Mondou et Mike Polich qui avaient tous les deux passé l'entièreté de la saison 76-77 en Nouvelle-Écosse avant de rejoindre le CH comme renforts en finale suite à leur coupe Calder, les deux championnats étant décalés de quelques semaines.
----------------
On retrouve également le coach Jacques Lemaire et son ancien coéquipier comme assistant, Larry Robinson. On retrouve également une première dans cette série car c'est la première fois que je vois l'inclusion du coach du club-école, ici Robbie Ftorek. Ce dernier avait probablement mérité sa place dû à la conquête des River Rats discutée plus tôt.
Mais ici je porte mon choix sur le vénérable Marcel Pronovost, dont j'ignorais totalement qu'il avait, après une longue carrière qui le mena au temple de la renommée, été à l'emploi des Devils comme recruteur. Mais avant ça il avait tenté sa chance comme entraineur à divers niveaux, notamment comme entraineur des Sabres pendant deux saisons et aussi brièvement des Red Wings.
C'est en 1990 qu'il devint recruteur au New Jersey, et apparemment qu'il aurait grandement aidé ses patrons à choisir Martin Brodeur au repêchage de 1990. Il demeurera en poste jusqu'à sa mort en 2015.
C'était donc la finale de 1995 et ses noms gravés sur la coupe. Contrairement aux Devils, qui ont incompréhensiblement raté les séries l'année suivante, on se revoit en 1996.